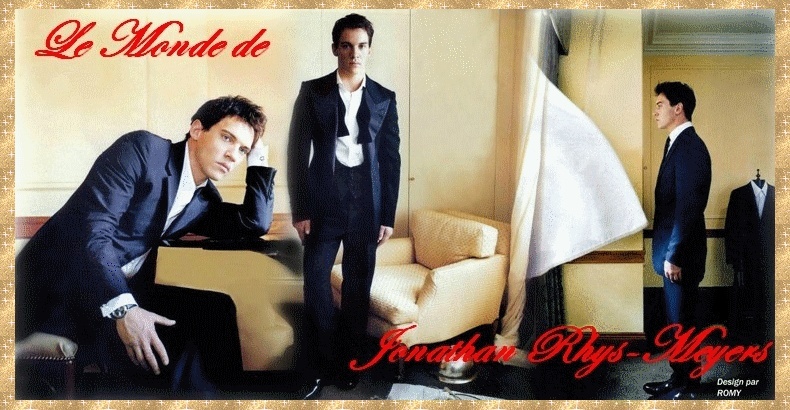|
| | et re fan-fiction... |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
xstiane
Prends place au salon



Nombre de messages : 59
Age : 66
Localisation : au soleil (de marseille!)
Date d'inscription : 08/04/2009
 |  Sujet: et re fan-fiction... Sujet: et re fan-fiction...  Ven 24 Avr - 21:01 Ven 24 Avr - 21:01 | |
| Salut à toutes et à tous!  Comme votre petit monde me plait bien, j'ai décidé de vous offrir la primeur du 1er chapitre du roman que je suis en train d'écrire.... Bien sûr, lorsque je décris mon personnage principal, vous aurez deviné à qui je pense.  J'imagine déjà le scénario d'un film avec Jonny dans le rôle principal..... Par contre, pour le 1er rôle féminin, j'ai du mal. Alors, j'attends votre avis. [justify][size=12]Graziella - Vendredi 4 avril 2008. 18h30.
Le vendredi a toujours été pour moi le meilleur moment de la semaine, la promesse de grands espaces de liberté solitaires et ininterrompus, où je peux rêver sans contrainte horaire ni matérielle. La solitude m'est indispensable et précieuse, tout comme le rêve et la musique, et à vrai dire, elle ne m'a jamais pesé: elle fait partie de moi comme une âme soeur et, souvent, j'ai partagé avec ces trois seuls amis mes peines et mes joies d'adolescente.
En cette fin de semaine, je m'apprête à profiter des derniers rayons de pâle soleil de cette belle journée presque printanière. Personne ne m'attend chez moi et, à cette période de l'année, j'aime rentrer à pied, le casque de mon balladeur vissé sur les oreilles, en flânant par les ruelles du quartier résidentiel où je loue un petit studio. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours aimé ce moment, ces derniers jours d'hiver où j'espère plus que je ne perçois l'éveil imminent de la nature. J'éprouve toujours le même plaisir enfantin à frissonner sous la fraîche caresse d'un vent qui laisse déjà présager sa tiédeur à venir. A deviner les jeunes rayons de lumière qui folâtrent parmi les branches nues des arbres à la recherche des bourgeons gonflés de sève et prêts à s'entrouvrir. A suivre le long des ruelles les timides sillages des premières fleurs qui émaillent l'air du soir. Il me semble que ce sentiment de bonheur irraisonné, primaire et entier, qui m'emplit inmanquablement en cette saison, doit être le même que celui qu'on éprouvé les êtres qui ont assisté au premier printemps du monde. J'ai aussi gardé de mon enfance le goût du contact privilégié avec la nature et, depuis près d'un an que j'habite ici, je connais les détails botaniques de ce quartier comme ma poche. Je pourrais dire sans hésiter de quelle variété d'arbre chaque rue est plantée, leur nombre exact et lequel d'entre eux va laisser entrevoir son feuillage le premier. Cette curieuse habitude de tout compter et de tout répertorier me vient de maman: c'était un jeu que nous avions entre nous quand j'étais toute petite, sans doute destiné à discipliner mon esprit naturellement rêveur et distrait, avide d'évasion. Dans les périodes difficiles de mon adolescence, cette habitude m'a aidée à me rassurer, à m'approprier le monde hostile autour de moi, tout en me faisant respirer un peu la douceur de mon enfance où j'allais me réfugier un instant.
Ces moments de liberté et de vagabondage solitaire sont peut être le seul réel bonheur de l'univers de ma vingtième année, avec la musique bien sûr, que j'écoute aussi souvent que possible. Ce premier emploi obtenu avec une chance presque insolente au service informatique d'une grande banque d'affaires, mon diplôme universitaire technique à peine en poche, m'a permis d'acquérir ma liberté et celle-ci est, pour moi, indissociable de la solitude. J'en éprouve un besoin viscéral, qui, aux dires de ceux qui me côtoient, me fait parfois friser l'autisme. Comme presque tous les soirs, je suis la dernière à quitter le service où j'aime m'attarder. Je goûte avec plaisir la lumière tamisée et le silence feutré qui, après dix huit heures, règnent enfin en maîtres dans les locaux de la banque délaissés par la majorité de ses occupants. L'atmosphère y est apaisée, plus douce, plus fraîche, comme dans la nature après une pluie d'orage. Il me semble que même les parfums y sont différents, à la fois plus tendres et plus individualisés.
Aujourd'hui, j'ai pour mission, avant mon départ, de vérifier les connexions réseau sur le poste informatique du directeur général, où une défaillance a été signalée. Un contrôle de routine qui ne me prendra sans doute guère plus de quelques minutes. Après quoi, je serai enfin libre! Je frappe à sa porte. Pas de réponse. Persuadée qu'il est déjà parti, je pénètre dans la grande pièce sombre et silencieuse. Je ne prends même pas la peine d'éclairer. Je me dirige tout droit vers son bureau vide et c'est en m'installant devant son ordinateur que, du coin de l'oeil, je perçois une présence dans le demi-jour. La silhouette longiligne que je devine à peine ne me trompe pas. Il est là, me tournant le dos, debout devant la fenêtre ouverte à l'opposé de la pièce, immobile, les bras le long du corps. Petit à petit, mes yeux s'habituent à la faible lumière et je distingue ses poings serrés, si serrés que je me dis que ses ongles doivent être enfoncés dans la peau de ses paumes. Par moments, des spasmes viennent briser l'immobilité de sa haute silhouette et le font ressembler à un grand cyprès secoué par le vent du soir.
L'espace d'un instant, il me vient à l'esprit qu'il a peut-être eu un malaise et que je devrais aller chercher du secours. Puis je me souviens des bruits qui courent parmi les employés de la banque à son sujet. Je me souviens surtout des paroles de Chloé, une des secrétaires du service contentieux, surnommée “Chloé-Les-Echos” par ses collègues, qui s'est prise de sympathie pour moi dès mon arrivée. “Je connais le directeur depuis plus de dix ans. A mes débuts je travaillais à son secrétariat particulier et je crois bien que je ne lui étais pas tout à fait indifférente... Et là, vois-tu, en l'espace d'à peine quelques mois, il a terriblement changé. Je peux t'assurer que ce n'est plus le même homme qu'auparavant. Bien que réservé et même un peu distant, il se montrait souriant et courtois avec tout le personnel sans distinction. Il savait toujours trouver pour chacun un petit mot aimable, un petit sourire charmeur. Puis, subitement, après son divorce, il est devenu sombre, sinistre même. Il s'est refermé comme une huître. Aujourd'hui, il n'adresse pratiquement plus la parole à personne en dehors de sa secrétaire et du directeur adjoint. Tu as pu constater que c'est tout juste s'il salue les autres employés lorsqu'il les croise dans les couloirs. Je me demande même s'il voit encore les gens autour de lui. Parfois il a l'air totalement désespéré... Les gens supposent qu'il a mal vécu le fait que sa femme l'ait quitté pour un autre. Mais à mon avis, il y a autre chose là dessous, quelque chose de pas clair, si tu vois ce que je veux dire...” Et là, elle a plissé un peu les yeux et m'a gratifiée d'une petite moue entendue en opinant de la tête. Certainement, son opinion sur la question était déjà toute faite et elle ne pouvait pas douter que, comme les autres, je la partageais sans restriction. Les talents de psychologue de Chloé ne sont-ils pas censés être universellement reconnus parmi tous nos collègues?
En fait, je ne voyais pas du tout ce qu'elle voulait dire mais je me suis bien gardée de poser la moindre question, certaine que j'étais, au fond de moi, qu'il était plus difficile de connaître les méandres du coeur humain qu'elle ne le supposait et que le tableau qu'elle avait longuement et minutieusement brossé pour moi ne pouvait m'offrir qu'un pâle reflet de la personnalité de cet homme. D'autant que j'avais beaucoup de mal à penser que ses allégations aient pu être fondées sur de quelconques confidences qu'il lui aurait faites car s'il était vraiment aussi introverti et réservé qu'elle le décrivait, Chloé représentait, à n'en pas douter, la dernière personne à qui il aurait pu être tenté de se confier.
D'ailleurs, en y repensant, je dois bien avouer que l'impression que j'ai gardée de notre première entrevue, l'année dernière lors de mon bref entretien d'embauche, diffère sensiblement du portrait de Chloé. C'est celle d'un personnage qui ne ferait pas vraiment partie de notre monde d'aujourdh'ui – peut-être même pas partie de notre monde tout court. C'était la première fois que je le rencontrais et, en dépit de tout le soin que mes futurs collègues, déjà pleins de sympathie pour ma jeunesse et mon inexpérience, avait pris afin de me préparer à ce moment, je ne m'attendais guère au spectacle qui allait s'offrir à mes yeux en me retrouvant face à lui. Lorsque je suis entrée dans son bureau et qu'il s'est levé de son fauteuil et s'est avancé vers moi pour venir me saluer, grand, très mince et très élégant dans son costume sombre, avec cette démarche nonchalante si particulière, il m'est apparu comme un seigneur moyennâgeux, aux manières courtoises mais distantes et glaciales. Ce fut soudain comme si j'avais parcouru en un instant toute la distance inconmensurable qui séparait nos deux univers et que je me retrouvais là devant lui, haletante et en sueur, totalement vidée de mes forces par ce terrible effort, figée et abandonnée à moi-même. Je me sentais comme Cendrillon en guenilles devant le prince charmant!
Mais davantage encore que son allure aristocratique, c'est la plastique parfaite de son visage qui m'a tout de suite impressionnée, paralysée même, à tel point que, par la suite, je n'ai plus jamais osé le regarder en face ni lui adresser ouvertement la parole. Une fois - la seule fois où il lui est arrivé de s'adresser directement à moi, en fait - je me suis même surprise à répondre tête baissée en bredouillant à la question pourtant simple et anodine qu'il me posait. Ce comportement n'a certes pas contribué à élargir notre intimité! Il m'a par contre valu en retour un regard. Pas, comme je m'y attendais, le regard courroucé et impatient d'un directeur général face à une employée incompétente. Juste un regard surpris, interrogateur, peut-être même légèrement inquiet. Mais du coup, un regard plus long et un peu plus insistant que ceux auxquels j'avais eu droit jusqu'alors. Un flash bleu acier, comme la lame acérée et pourtant innocente d'une épée, qui m'a littéralement transpercée puis, à son insu, a fourragé un long moment dans mes entrailles. Un regard que je n'oubierai pas. Dailleurs, plus que sa beauté elle-même, je dois reconnaître que c'est surtout son regard qui me bouleverse – davantage encore depuis ce malheureux incident, je dois l'avouer. Ces yeux d'un bleu parfois si intense et si pur qu'on dirait deux fragments de ciel égarés sur terre et qui, lorsqu'ils se posent sur moi, me semblent pouvoir pénétrer jusqu'au plus profond de mon âme. Des yeux à qui je suis convaincue que je ne pourrai jamais rien cacher.
| |
|   | | xstiane
Prends place au salon



Nombre de messages : 59
Age : 66
Localisation : au soleil (de marseille!)
Date d'inscription : 08/04/2009
 |  Sujet: La suite.... Sujet: La suite....  Ven 24 Avr - 21:03 Ven 24 Avr - 21:03 | |
| Voici la suite du chapitre qui ne rentrait pas tout entier...   Ma timidité maladive aidant, je n'ai guère eu l'occasion de l'approcher et je ne sais que très peu de choses sur lui, seulement ce que les autres employés se disent en chuchotant dans les couloirs. J'ai imaginé tout le reste au détour des histoires que je me raconte souvent au moment de m'endormir. Des histoires de petite fille qui peuplent ma solitude et offrent un immense terrain de jeu à mon imagination débordante. Des histoires dont les gens que je cotoie tous les jours sans les connaître vraiment deviennent le personnages involontaires et où ils vivent des aventures qu'ils sont bien loin de soupçonner. A partir de quelques traits de caractère, de quelques mots prononcés, ou parfois seulement de la mélodie d'un nom ou du souvenir d'un visage, je me bâtis des romans silencieux qui se prolongent ensuite dans mes rêves.
Les rares fois où il a été le héros de ces histoires, superposant mes propres impressions et celles de Chloé, j'avais fini par le surnommer “le prince d'Aquitaine à la tour abolie”, sans vraiment savoir pourquoi ces vers de Gérard de Nerval avaient subitement ressurgi des confins de ma mémoire d'écolière. Je lui prêtais un inconsolable chagrin d'amour qui le faisait parcourir le monde sur le dos de son grand coursier noir et séduire des femmes sublimes qu'il abandonnait sans même un regard sur son passage. Quant à moi, j'incarnais toujours la petite servante en guenilles d'une auberge sur laquelle il laissait involontairement traîner un instant son regard rêveur. Pourquoi l'ai-je ainsi imaginé en Casanova taciturne et solitaire? Je ne saurais le dire. Sans doute la rigueur classique et froide qui caractérise aussi bien son visage que son comportement a-t-elle influencé mon jugement et me l'a-t-elle fait imaginer plus volontiers sous les traits d'un grand séducteur plutôt que sous ceux d'un époux bafoué et abandonné que Chloé et la majorité des femmes de son entourage rêvent de consoler. Sans doute la distinction naturelle qui émane de lui l'at-elle préservé de ma pitié? Ou suis-je simplement incapable d'en éprouver? Plus tard, laissant mon imagination broder autour du personnage que j'avais ainsi créé, j'en suis arrivée à la conclusion que mon prince d'Aquitaine avait lui-même creusé des douves tout autour du château de sa vie intime et qu'il avait jeté les clés du pont-levis à l'endroit le plus profond et le plus inaccessible. Peut-être les y avait-il perdues à jamais?
Pourtant, je ne peux me résoudre à croire qu'il s'est voué à une éternelle solitude. Car il me paraît évident qu'un homme aussi beau, aussi riche et de surcroît célibataire, ne doit pas être en mal de conquêtes et que si, de l'aveu même de Chloé, personne parmi les employés de la banque ne lui connait d'aventure, c'est qu'il a simplement dû vouloir éviter de mêler sa vie professionnelle et sa vie privée. Ainsi, à mes yeux, ses manières volontairement sèches, bien que toujours courtoises, n'ont-elles pour but que d'empêcher les membres féminins du personnel de la banque, quel que soit leur rang, de l'approcher de trop près. J'ai la conviction que Chloé se trompe en le croyant désespéré par son échec conjugal et en supposant qu'il s'est muré dans sa souffrance qui l'empêche de prêter attention aux autres.
Pour moi, cet air distant et hautain qu'il affiche volontiers n'est qu'un masque destiné à protéger son intimité et je reste persuadée qu'il est bien loin d'être indifférent aux gens qui l'entourent. Pour preuve ce détail qui ne m'avait pas frappée sur le moment et qui m'est soudain revenu en mémoire: il y a quelques mois – le jour précisément où il m'a “flashée” du regard – toute l'équipe des informaticiens l'accompagnait avec Pierre Alessandrini à un rendez-vous à l'extérieur. C'était un matin d'hiver particulièrement froid et pluvieux. Nous étions tous installés au chaud dans les voitures et nous n'attendions plus que lui pour partir. Je le revois sortir de la banque de son pas nonchalant, sans parapluie comme d'habitude, hésiter au moment de prendre place dans la voiture, se retourner, fouiller dans les poches de son manteau et s'avancer vers une porte cochère pour glisser un billet à un mendiant qui y avait trouvé refuge et auquel aucun d'entre nous, précoccupés que nous étions de notre confort personnel, n'avait même prêté la plus petite attention.
Et cependant, à le voir là, seul, debout dans la quasi-obscurité et le silence de cette pièce, je ne peux m'empêcher de penser que je me suis trompée jusque là, que ce masque n'est peut-être pas seulement destiné à protéger sa vie privée... Qu'en réalité ce n'est peut-être même pas un masque mais plutôt un pansement qui cache la chair mise à vif par une blessure. Voilà ce que murmure une petite voix à mon oreille incrédule devant la haute silhouette qui frémit, les poings serrés, les ongles enfoncés dans la peau de ses paumes...
Il ne se retourne pas. Certainement, il ne m'a pas entendue frapper ni même entrer. Tout au long de ma jeune vie, j'ai toujours haï les moments où j'ai je n'ai pu éviter de donner ma propre souffrance en spectacle. Par pudeur ou par fierté, je ne saurais le dire. Pour moi, la douleur doit rester invisible et secrète. Elle confine au sacré. Je ne connais que très peu cet homme qui est là, devant moi, mais il me paraît soudain évident qu'il en va de même pour lui. Quelle que soit la raison de son trouble, je suis sûre qu'il souhaite le garder enfoui. Et je me sens soudain coupable. Je voudrais n'être pas spectatrice de ce moment d'égarement qui lui appartient et auquel je ne me reconnais pas le droit d'assister. Il me semble que je suis entrée par effraction dans son bureau, dans son âme aussi peut être. Je voudrais me faire toute petite, me glisser dehors sans bruit et m'enfuir très loin. J'hésite un instant à ressortir en silence, comme une voleuse, comme un enfant, témoin coupable et pourtant innocent d'un secret d'adultes qu'il n'a fait qu'entrevoir mais dont il devine instinctivement le poids. Ce sentiment de culpabilité me retient pourtant et je reste plantée là, l'esprit englué dans une multitude de pensées contradictoires qui s'agitent et m'absorbent. Je sens ma volonté paralysée, incapable de me décider à faire le moindre mouvement. Il me semble que j'ai dû rester là longtemps, hagarde, sans parler ni bouger, bercée par le tic-tac inutile de la pendule murale, les yeux baissés, occupés à suivre minutieusement les dessins géométriques de la moquette bleue, cherchant désespérément à trouver sur cet océan artificiel un hypothétique sillage pour m'évader. Trois cercles, un carré, deux cercles...
Mon corps frissonne soudain, et, instinctivement, je m'approche et je me glisse dans l'espace entre lui et la porte fenêtre largement ouverte pour la refermer. Puis je me retourne et, alors, je lui fais face. Il n'a pas bougé: il est debout, tout proche de moi, si proche qu'il me suffirait d'avancer un peu la main pour le toucher. Son regard, perdu au loin, me traverse sans me voir, comme si j'étais devenue transparente. A ce moment, je comprends confusément que je ne pourrai supporter longtemps cette vision. C'est trop douloureux, comme si on m'obligeait à regarder le soleil en face. Il y a quelque chose d'insoutenable dans le spectacle de cette souffrance, quelque chose de trop violent, de trop direct. Je dois cligner des yeux. Je sens même qu'il faudrait que je les baisse, qu'à nouveau je les plonge dans la moquette pour trouver un soulagement, un échappatoire. Mais j'en suis incapable. Mon cou refuse de se plier et mes yeux dilatés ne peuvent que suivre les vagues qui le parcourent, fascinés, hypnotisés.
Et tout à coup, je m'avance d'un pas et, dans un mouvement instinctif, je le prends dans mes bras. J'ignore la raison qui m'y pousse. C'est peut être la seule solution que j'ai trouvée pour cesser de le voir. Et je me mets à le serrer très fort, aussi fort que je peux. Je ralentis ma respiration. Je ne ressens plus rien à présent, juste la surprise d'être à peine plus petite que lui et d'avoir à pencher un peu la tête pour aller la cacher au creux de son épaule, là tout contre son cou. Le tissu soyeux de sa chemise est glacé par l'air froid du soir. Je déploie mon corps sur lui, tentant de le réchauffer à mon contact, ou peut-être de me rechauffer au sien. A ce moment, je ne sais plus très bien qui serre l'autre dans ses bras. J'entends les coups violents et désordonnés de mon coeur dans ma poitrine. Ou peut- être est-ce le sien. Je ne sais pas. Un animal prisonnier qui se débat en tous sens pour essayer d'échapper à l'étreinte mortelle du piège qui l'engloutit. Et toujours la pendule au mur qui s'obstine à morceller l'espace de nos vies.
Je n'aurais pas soupçonné qu'un jour je pourrais être capable d'un tel geste. Je me souviens pourtant aujourd'hui d'avoir été une petite fille tendre, expansive et caline, recherchant sans relâche les bras de mes parents. Mais durant les dix années où j'ai vécu en foyer après leur mort, je me suis si bien appliquée à taire mes sentiments et à réfréner mes pulsions par crainte des brimades et des moqueries, que je suis devenue une sorte d'ours solitaire. Par la suite, je n'ai jamais plus su prendre dans mes bras une camarade en pleurs pour la consoler de ses chagrins, me contentant de baisser les yeux pour éviter d'affronter le spectacle de la détresse humaine. Sans doute cette cassure dans ma vie a-t-elle été la cause d'une espèce de décalage et, à présent, ce n'est souvent qu'a posteriori que j'ai la vision des gestes qui auraient dû accompagner mes sentiments. Comme si quelque chose s'était détraqué au fond de moi. Mais ce soir, précisément, quels sentiments se sont exhalés de mon coeur comme des génies longtemps retenus prisonniers qui s'échappent soudain d'une lampe? Je réalise que ce n'est pas un sentiment de compassion ou de pitié face au spectacle de sa douleur qui a dicté ma conduite. Ce qui m'a guidée aveuglement vers ses bras est une force irrésistible et impétueuse, une intuition pure, un instinct animal - la seule part de sacré qui demeure peut-être en l'homme. Ce qui a bousculé tous mes doutes et mes hésitations, ma retenue et ma timidité, c'est un besoin profondément enfoui en moi de chaleur et de tendresse qui a soudain refait surface. Un désir de chaleur humaine.
Il n'a pas bougé et je ne suis même pas sûre qu'il ait perçu ma présence. Sa respiration est toujours haletante. Machinalement, ma main droite s'est mise à caresser doucement sa nuque. Surprise par la légère piqûre de ses cheveux très courts, elle recule, recherchant la douceur du cou où elle est tentée de s'enfoncer sous le col ouvert de la chemise. Au passage, mes doigts rencontrent un petit havre tiède et doux, juste derrière son oreille, où s'attarder un instant. Je prends soudain conscience de l'incongruïté de mon geste et je force ma main à redescendre sagement sur son épaule tout en continuant à le serrer silencieusement contre moi. Tout à coup, les larmes me viennent aux yeux, une sourde angoisse m'étreint la gorge, comme si je venais d'absorber moi-même sa propre douleur, comme si l'onde de choc qui l'a traversé m'avait ensuite frappée de plein fouet. Comme si les limites matérielles entre nous n'existaient plus, et que, désormais, nos corps ne faisaient plus qu'un. Je sens mes forces me trahir et je chancelle. Je me blottis encore plus près de lui et, tout à coup, je perçois la légère pression de ses bras sur mes épaules.
Dès que je me rends compte qu'il a pris conscience de ma présence, dans une réaction instinctive plus que par un comportement réfléchi, je m'oblige à relâcher légèrement mon étreinte, pour lui laisser la liberté de s'écarter s'il le désire. La liberté d'affirmer s'il le souhaite la distance qui nous sépare. Mais il ne bouge pas et nous restons enlacés et immobiles, unis dans un moment d'éternité. Je ne sais combien de temps nous avons pu demeurer ainsi, dans une totale inconscience du monde qui nous entoure. A présent, il respire plus doucement et les battements toujours irréguliers de son coeur se sont assourdis. Je me laisse aller, enveloppée de la douce tiedeur de son corps et d'un léger parfum de violette, qui me rappelle les fleurs que ma mère faisait sécher dans ses livres et que je n'oublierai plus.
Au bout d'un long moment, il s'anime imperceptiblement et dit enfin mon prénom dans un souffle, d'une voix sourde et étranglée, que j'ai du mal à reconnaître. Il me serre plus fort dans ses bras pendant quelques secondes, puis il s'écarte un peu de moi, pose ses mains sur mes épaules et bientôt de chaque côté de mon visage et alors, il plonge ses yeux au fond des miens. Deux fragments de ciel qui me donnent le vertige. Je suis au bord de la perte de conscience tant j'ai peur de ce moment où il me regarde de si près et si intensément. Je voudrais détourner un peu la tête, cacher mon visage gonflé et rougi par les pleurs contre son épaule mais ses mains solides me retiennent. Il me contemple un instant puis se met à me parler tout doucement, d'une voix suave, comme on parle à un enfant pour l'aider à s'endormir. Il me parle et j'écoute cette voix comme une douce chanson, une berceuse dont les paroles me seraient inconnues mais dont la mélodie me fascine. Puis, tout à coup, le sens des mots devient clair et le sortilège se brise. - Je vais vous ramerner chez vous. Nos deux corps se séparent et redeviennent étrangers.
Il fait nuit noire dans la pièce que les lumières de la rue n'atteignent pas. Lorsque je lève enfin les yeux vers la pendule murale qui n'a pas cessé son découpage obstiné, je vois qu'il est vingt-trois heures quinze. Je quitte son bureau et je retourne machinalement dans le mien sans rien voir autour de moi. J'enfile ma petite veste, je prends mon sac sur l'épaule et j'attends, debout, la tête baissée, les bras le long du corps, comme une marionnette oubliée dans un placard. Puis j'aperçois l'ombre de sa haute silhouette dans l'encadrement de la porte et je le suis mécaniquement jusqu'au parking sous-terrain. Il m'ouvre la portière pour que je prenne place dans sa voiture. Durant le court trajet, nous n'échangeons pas un seul mot. Je suis totalement incapable de parler et j'ai à peine la force de lui dire un timide “merci” lorsqu'il me dépose devant chez moi. Aussitôt, la voiture redémarre et s'enfonce dans la nuit. | |
|   | | | | et re fan-fiction... |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |